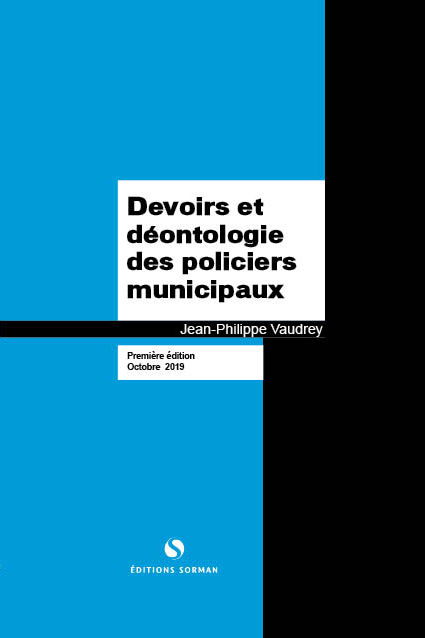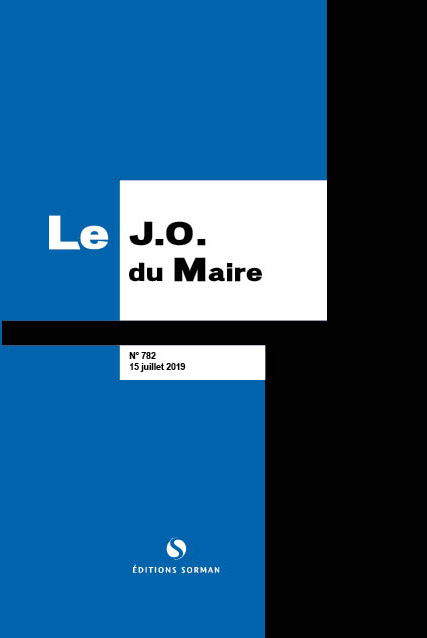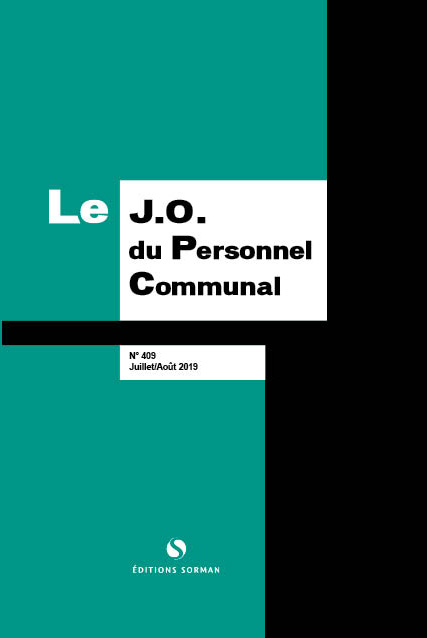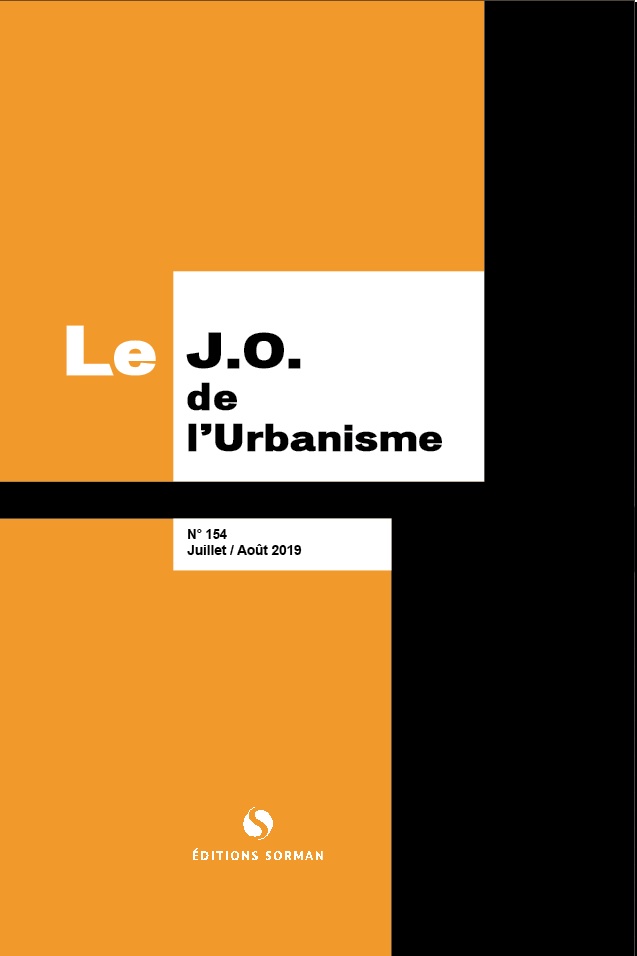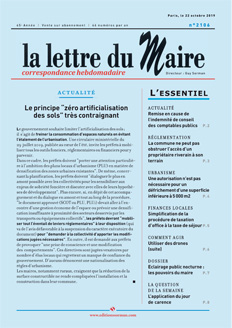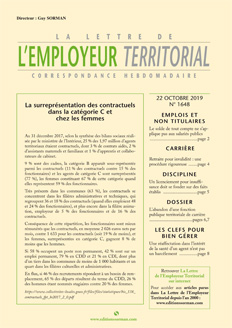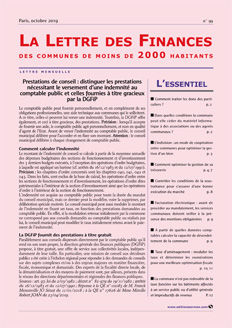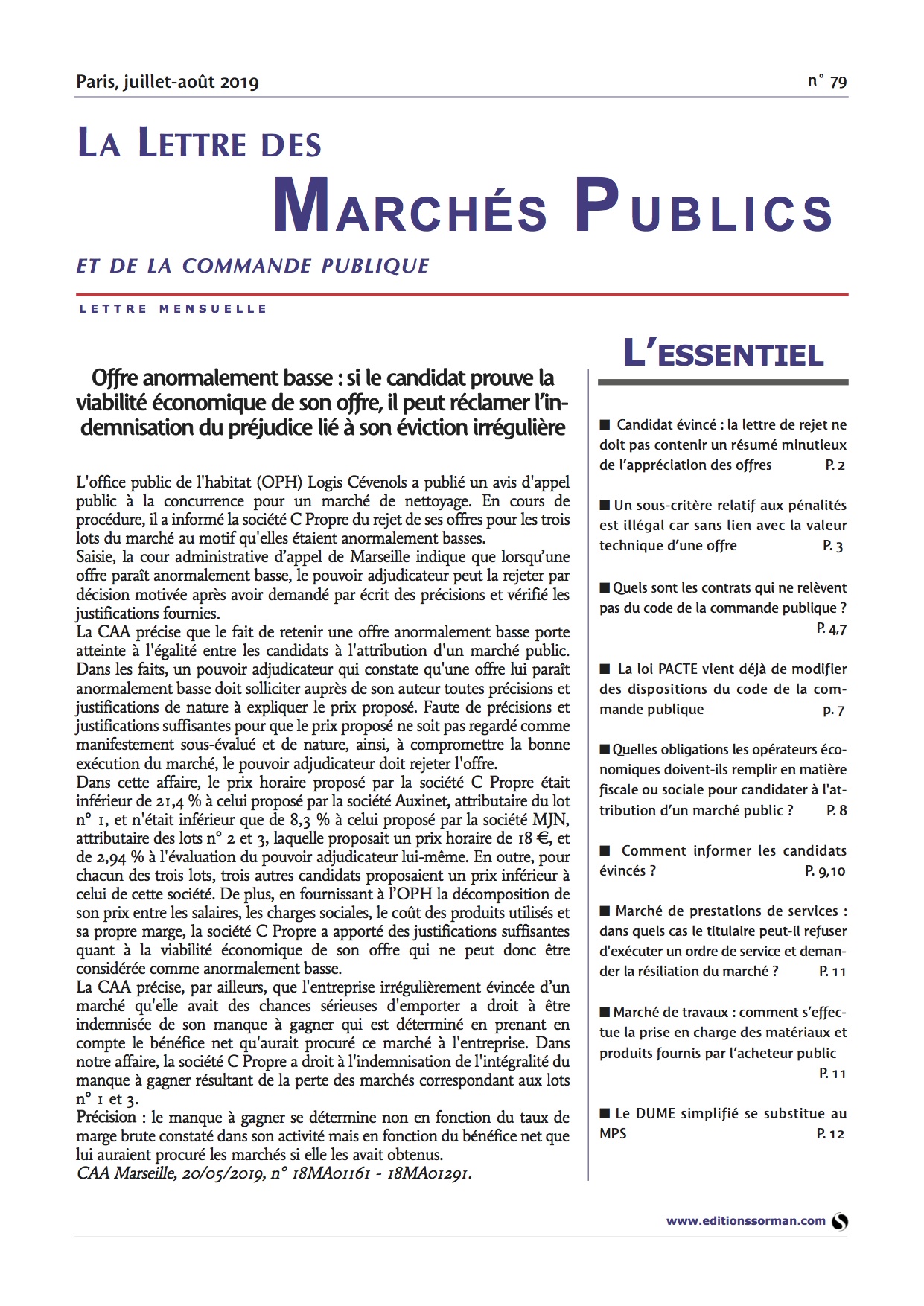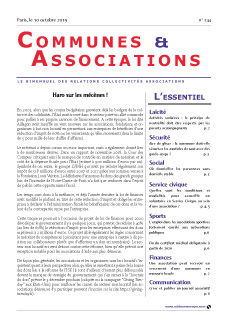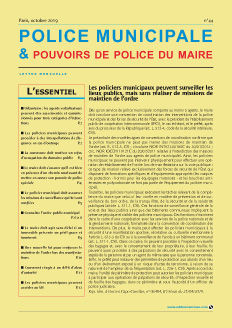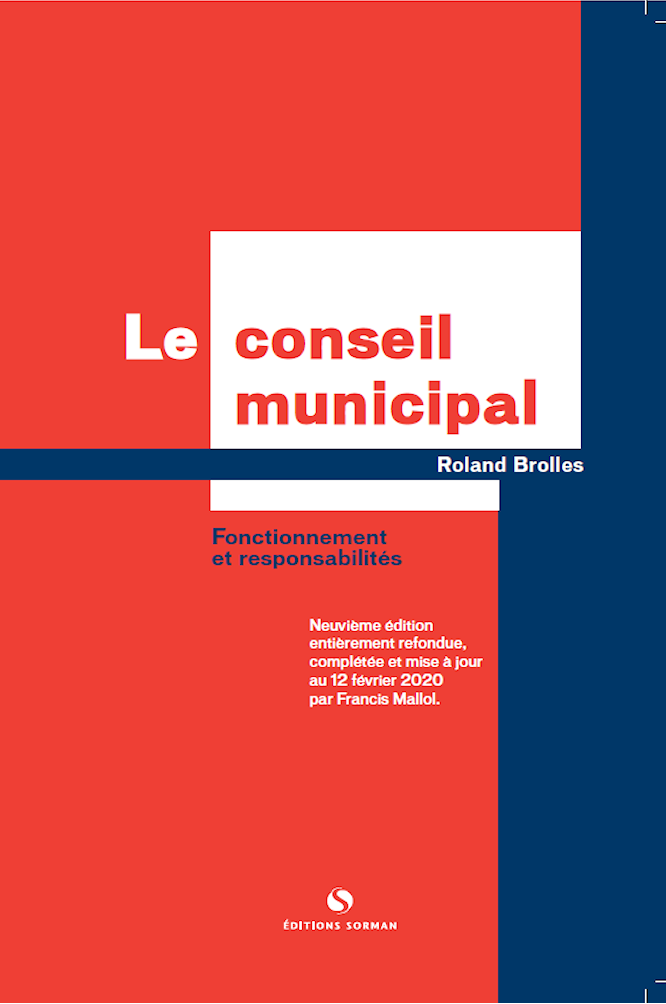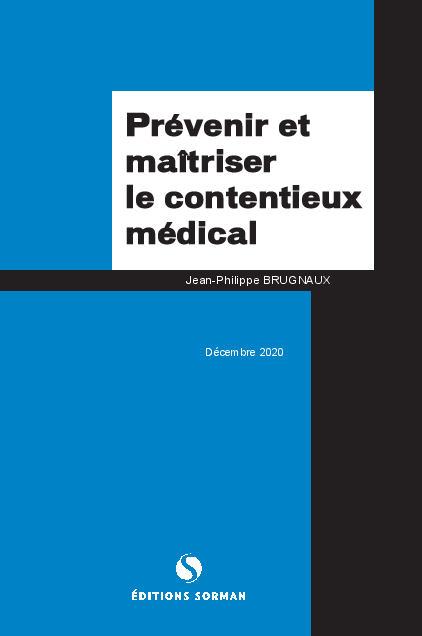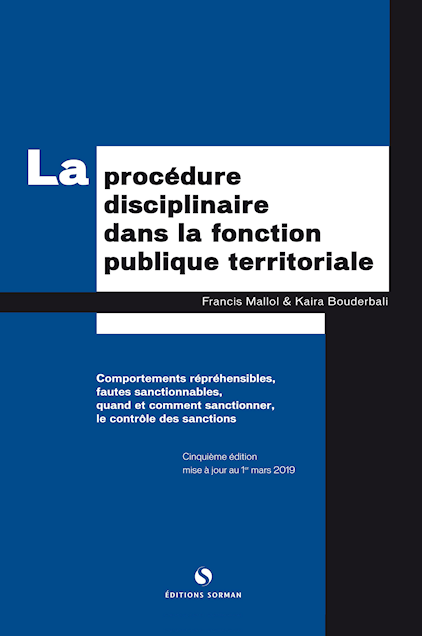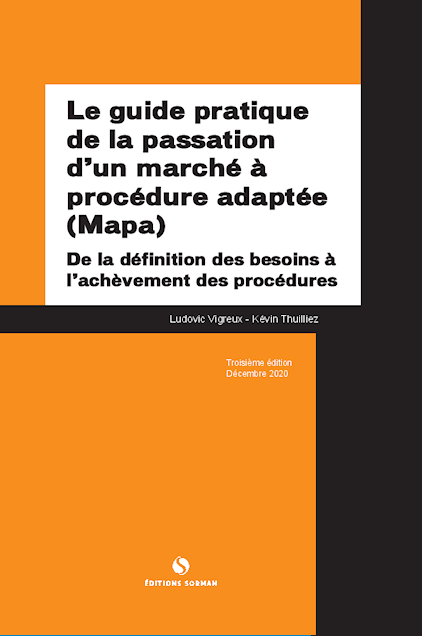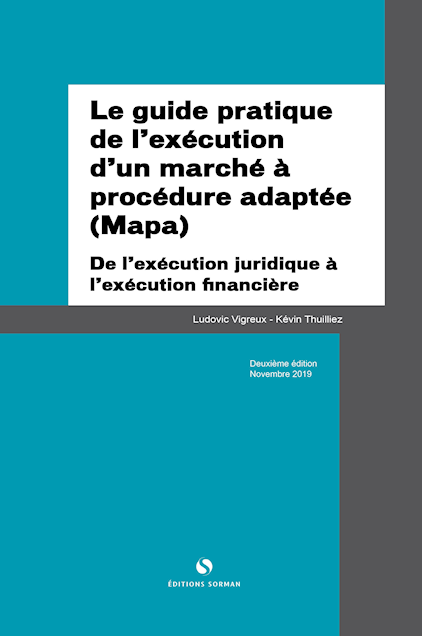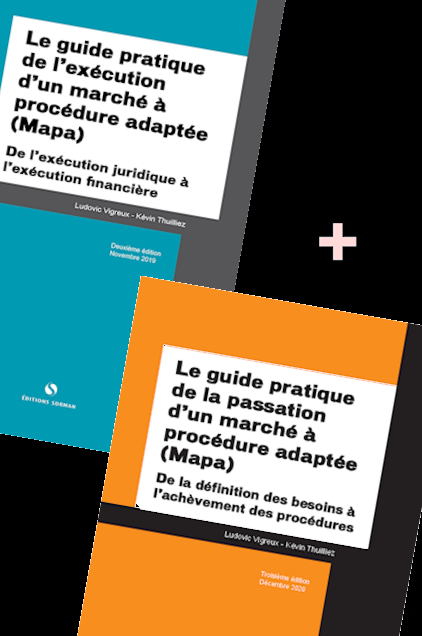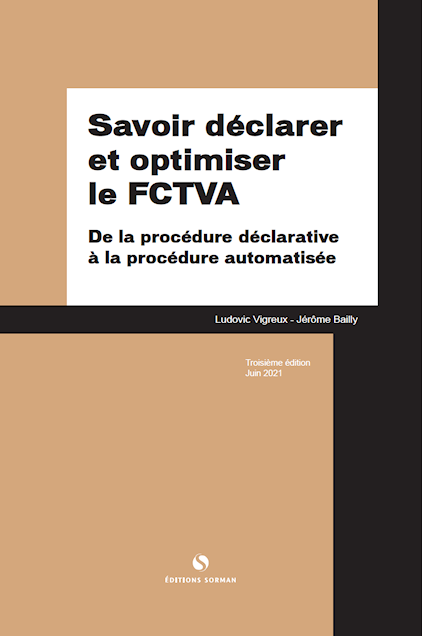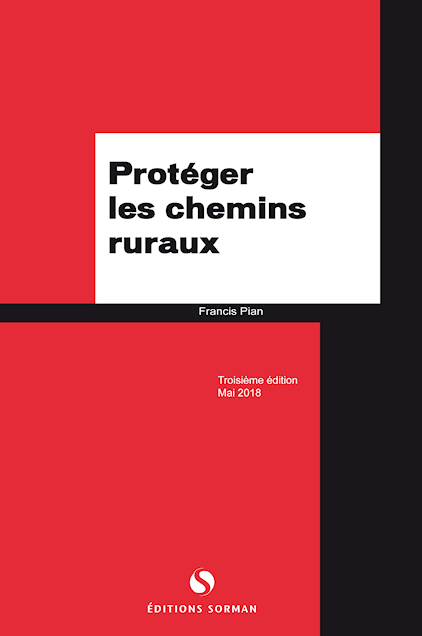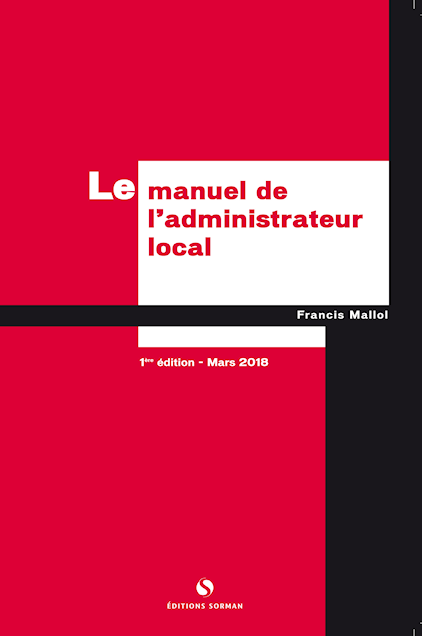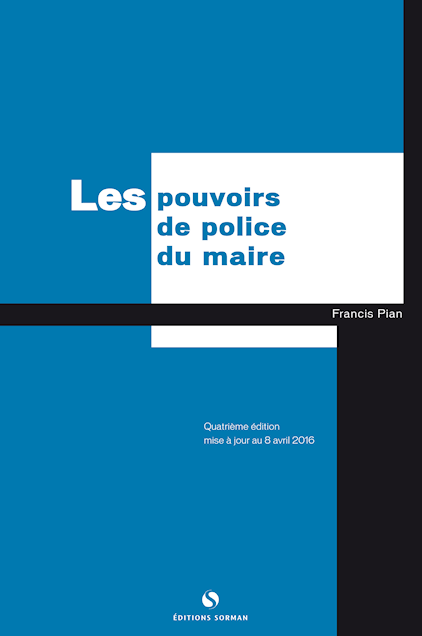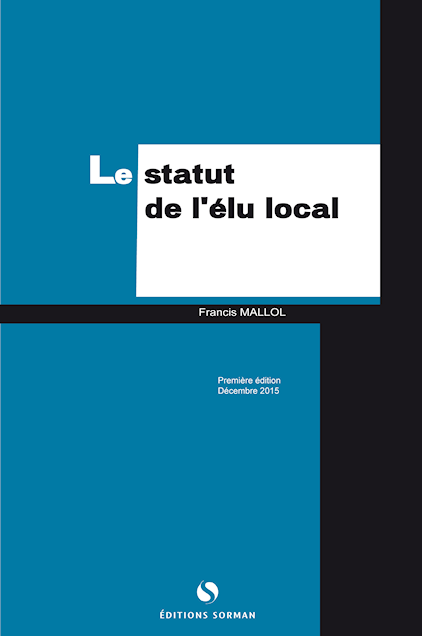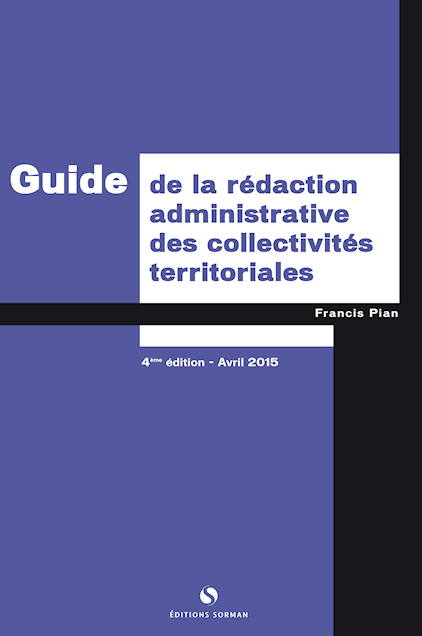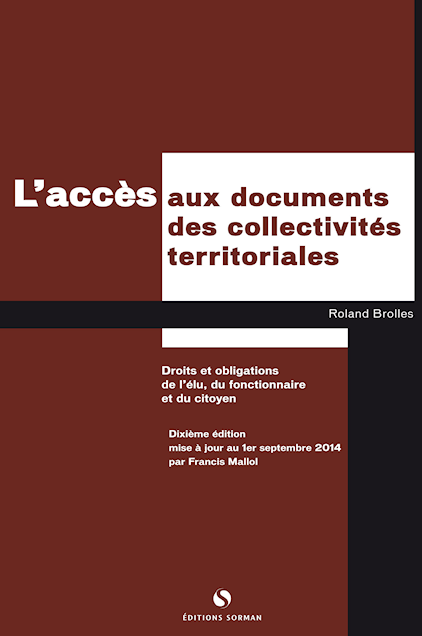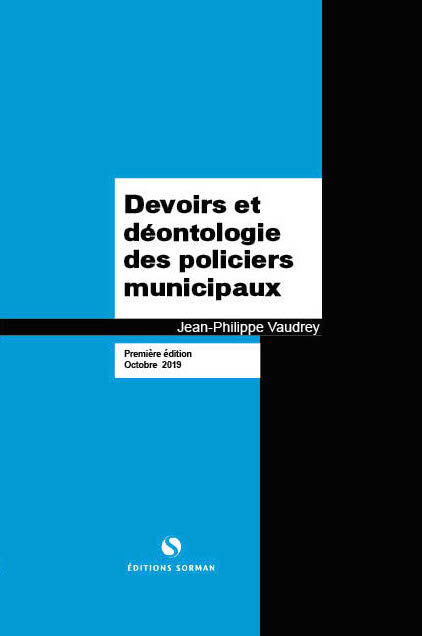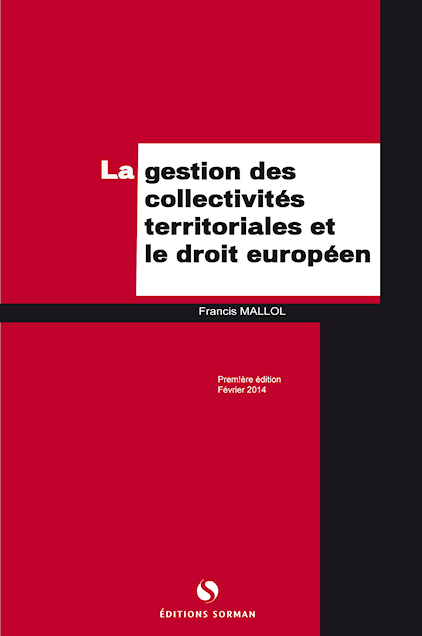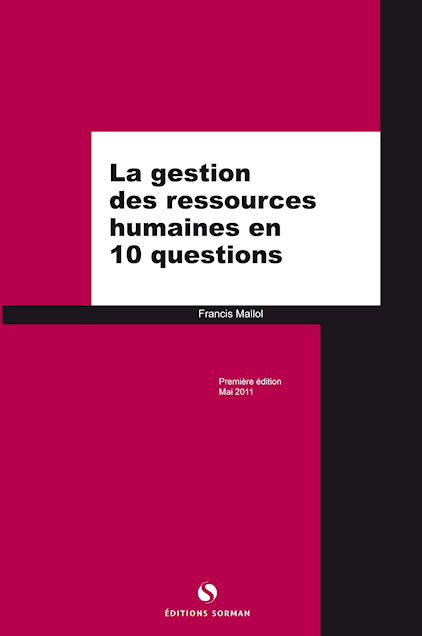Les garanties d’emprunts accordées par les communes : indolores mais risquées Abonnés
Les conditions des garanties d’emprunts
Les garanties accordées par les communes doivent répondre à des conditions de forme et de fond, à peine de nullité.
Conditions de forme
- l’exigence d’une délibération. Le conseil municipal doit prendre une délibération autorisant le maire à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’emprunt du tiers. La délibération doit nécessairement comporter, avec précision, le nom de l’établissement prêteur, l’objet exact de l’emprunt et ses conditions, c'est-à-dire notamment son montant, son taux, sa durée, la quotité garantie. A défaut, le juge annulera la délibération, en particulier si elle se borne simplement à indiquer que la garantie est limitée aux sommes empruntées et pouvant atteindre, éventuellement, un montant total de 5,3 millions d’euros (CE, 28/10/2002, Cne de Moisselles, n° 232060).
- la délibération doit être exécutoire. La délibération doit être exécutoire, c'est-à-dire que la garantie ne peut intervenir avant que la délibération ait été adressée au préfet (CE, 8/03/2002, Géron, n° 234650). Le signataire de l’acte doit être le maire, ou un adjoint en cas d’absence ou d’empêchement. Le juge administratif a considéré que même si l’acte est signé par un adjoint alors que le maire n’est ni absent ni empêché, la commune est engagée par sa délibération et son engagement lui est opposable (CAA Paris, 13/12/1994, Antoine, n° 94PA00296).
Attention : seul le conseil municipal est compétent pour accorder une garantie d’emprunt. La délibération ne peut déléguer cette compétence au maire, celui-ci ne disposant en cette matière, d’aucun pouvoir d’appréciation (CE, 15/06/1994, Cne de Longueau, n° 137690). Il n’est compétent que pour signer l’acte. Néanmoins, si le maire dépasse l’habilitation donnée par la délibération du conseil, l’arrêté l’octroyant est inopposable (CE, 27/10/2000, Sté BFG Bank Luxembourg SA, n° 172350).
Conditions de fond
Les engagements des communes sont limités par 3 règles cumulatives : plafonnement des engagements (1), plafonnement des bénéficiaires (ou division du risque) (2) et partage du risque (3). Ces ratios prudentiels ne sont applicables que pour les seules garanties d’emprunts accordées aux personnes privées. Aucune disposition ne vient limiter les garanties octroyées aux personnes morales de droit public. Le plafonnement des engagements (1) empêche la commune de garantir plus de 50% du montant total des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal (art. L. 2252-1 et D. 1511-32, CGCT). Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur (2) ne doit pas être supérieur à 10% du montant total susceptible d’être garanti (art. D. 1511-34, CGCT). Le débiteur ne peut disposer d’une couverture excédant, en termes d’annuités, le 10ème de la capacité à garantir de la commune. Cette disposition n’est pas applicable pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux (art. L. 2252-2, CGCT).
Enfin, la quotité maximale (3) que les collectivités peuvent garantir sur un même emprunt est fixée à 50% : un emprunt ne peut pas être totalement garanti par les collectivités (art. D. 1511-35, CGCT).
Les garanties accordées pour ces interventions en matière de logement social ne doivent pas être prises en compte dans le calcul ni du ratio budgétaire des annuités déjà garanties ni dans le calcul de la règle de division du risque (CAA Bordeaux, 20/12/2005, Préfet de la Réunion c/ Cne de La Possession, n° 02BX02279).
Attention : des exceptions sont prévues pour certaines opérations. Ainsi, la quotité maximale susceptible d’être garantie (3) peut être portée à 80% pour les opérations d’urbanisme menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme (art. D. 1511-35 al.2, CGCT). La limite de quotité n’est pas applicable aux garanties d’emprunts accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238bis du CGI, soit principalement les organismes à caractère éducatif, social, humanitaire ; les collectivités peuvent donc garantir en totalité leurs emprunts (art. L. 2252 1 al. 5, CGCT).
Une convention de garantie inutile
Il n’existe aucune obligation imposant de conclure une convention de garantie d’emprunt entre la commune et le prêteur ; la délibération prise par le conseil municipal suffit à établir l’engagement de la commune (TA Marseille, 16/05/1995, Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités annexes). Par conséquent, la commune ne peut pas s’exonérer de son engagement au motif de l’absence d’une telle convention (Civ. 1re, 9/01/2007, n° 06-11.318). Cependant, si une convention est conclue entre le maire, seul compétent pour la signer, et le prêteur, celle-ci doit respecter les dispositions de la délibération au risque de rendre nulle et inopposable la garantie, entraînant alors la responsabilité de la commune pour faute (CE, 27/10/2000, Sté BFG Bank, op. cit.).
La compétence de principe du juge judiciaire tempérée
Dans la majorité des cas, la convention de garantie est un contrat de droit privé puisqu’étant l’accessoire d’un contrat principal de prêt, lui-même de droit privé (CE, 29/12/1995, SA Natio Energie, n° 143861). En revanche, si le contrat de prêt est de nature administrative, en raison de son caractère administratif ou s’il comporte des clauses exorbitantes ou s’il a pour objet l’exécution d’une mission de service public, la convention sera de nature administrative (T. confl., 22/06/1998, Agent judiciaire du Trésor c/ Miglierina, n° 3003) et relèvera de la compétence du juge administratif.
Un provisionnement dès que le risque est avéré
Lorsque la commune octroie une garantie d’emprunt, elle n’est pas tenue de la provisionner. Toutefois, dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, la commune doit constituer une provision pour les garanties accordées à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective (art. R. 2321-2-2°, CGCT). Cette provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru.
Conseil : dès que le risque est avéré, la commune a intérêt à provisionner le montant de la garantie d’emprunts afin de prévenir un éventuel appel. Note : en pratique, la provision n’apparaît pas dans le budget mais le conseil municipal peut décider, par délibération, d’inscrire son montant en recettes de la section d’investissement par une opération d’ordre budgétaire (art. R. 2321-3, CGCT). Dans ce cas, la reprise ultérieure des provisions, lorsque le tiers est défaillant, entraîne l'inscription de la dépense à la section d'investissement et de la recette équivalente à la section de fonctionnement.
Mise en œuvre de la garantie
En cas de défaillance du tiers, la garantie se réalise et la commune doit verser les sommes dues en ses lieux et place. La commune est cependant libre de mettre en jeu les garanties accordées, selon sa préférence, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel sans qu’aucune stipulation ne puisse y faire obstacle (art. 10 de la loi n° 88-13 du 5/01/1988, art. L. 2252-1 al. 6, CGCT).
S’il existe des désaccords dans la mise en jeu de la garantie, le litige sera porté devant le juge judiciaire si la convention de garantie est de droit privé. Il en est de même en l’absence de toute convention si la délibération est régulière. Le contentieux peut aussi être porté sur la seule délibération du conseil municipal devant le juge administratif qui pourra être saisi soit directement soit par le biais d’une question préjudicielle émanant de la juridiction judiciaire (Civ. 1re, 31/03/2010, Cne de Saint-Amand-Les-Eaux, n° 09-10.936). Dans ce cas, le juge administratif ne peut connaître que des seules questions renvoyées par le juge judiciaire.
Par la suite, si la délibération est régulière, cette délibération engage la commune puisqu’aucune convention ultérieure n’est requise (CE, 4/11/2009, Aubert, n° 304701). S’il s’avère que le maire est allé plus loin que ce lui permettait la délibération, la commune n’est pas tenue d’honorer son engagement (CE, 2/03/2007, Cne de Condé-sur-Escot c/ CRAM, n° 2834389). En revanche, si la délibération est irrégulière, la convention de garantie est déclarée nulle et ne peut s’appliquer. Néanmoins, cette irrégularité entraîne la responsabilité de la commune pour faute, ce qui peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au profit du prêteur (CAA Marseille, 22/01/2002, Cne de Béziers, n° 99MA01744).
Lorsque la commune est appelée en garantie, la garantie d’emprunts devient une dette exigible et donc une dépense obligatoire (art. L. 1612-15 et L. 2321-2-32°, CGCT). Si la commune ne procède pas au paiement, le prêteur peut saisir la Chambre régionale des Comptes afin de constater que la dépense n'a pas été inscrite au budget. La Chambre adresse, dans un délai d’un mois, une mise en demeure à la commune (art. L. 1612 15 al. 2, CGCT). A défaut d’exécution, elle demande au préfet d’inscrire cette dépense et de l’exécuter (art. L. 1612-5 al.3).
Communication et suivi des engagements
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la liste des organismes pour lesquels des garanties d’emprunts ont été octroyées doit être annexée aux documents budgétaires (art. L. 2313-1, CGCT). La commune doit également transmettre au préfet et au comptable public, avec le compte administratif, les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune a garanti des emprunts (art. L. 2313-1-1, CGCT).
Conseil : l’enregistrement de la garantie au moment où elle est signée ne pose pas de difficulté. L’actualisation des engagements peut être plus problématique puisque l’information n’est pas toujours fournie ou est donnée tardivement. Les démarches doivent donc débuter assez tôt pour permettre de collecter, auprès des tiers emprunteurs, les informations comptables et financières. Celles-ci permettent d’évaluer la potentialité du risque et, le cas échéant, de provisionner.
Jacques KIMPE le 02 avril 2015 - n°334 de La Lettre des Finances Locales
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline