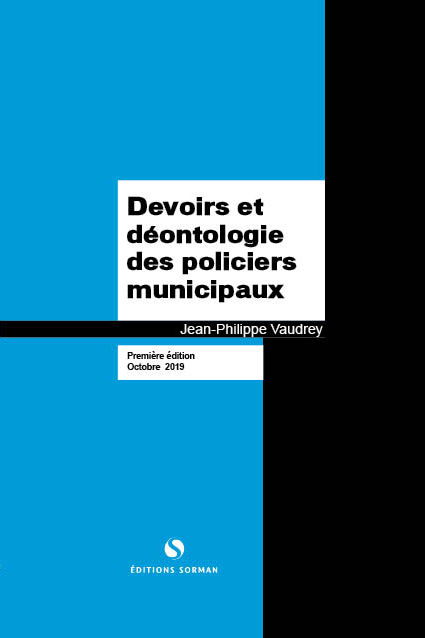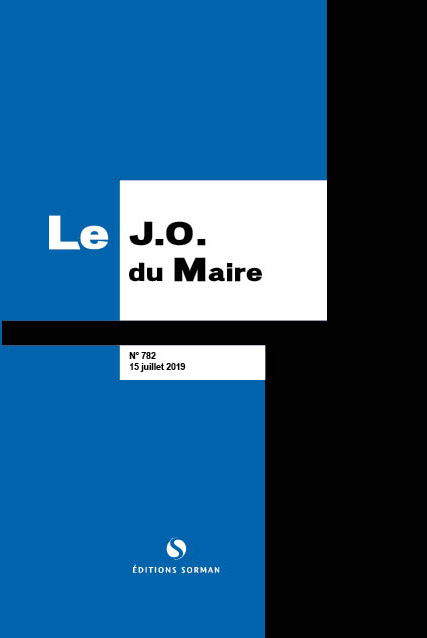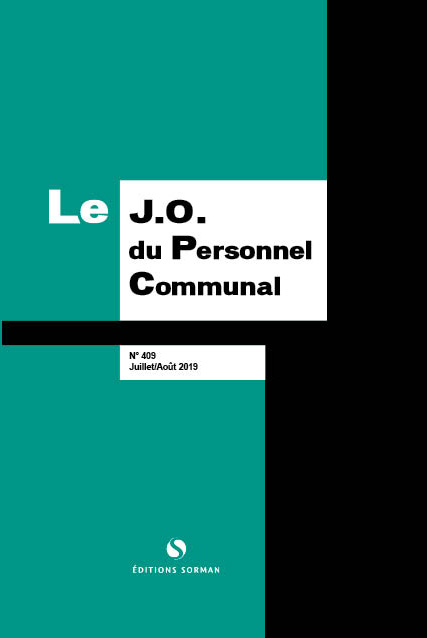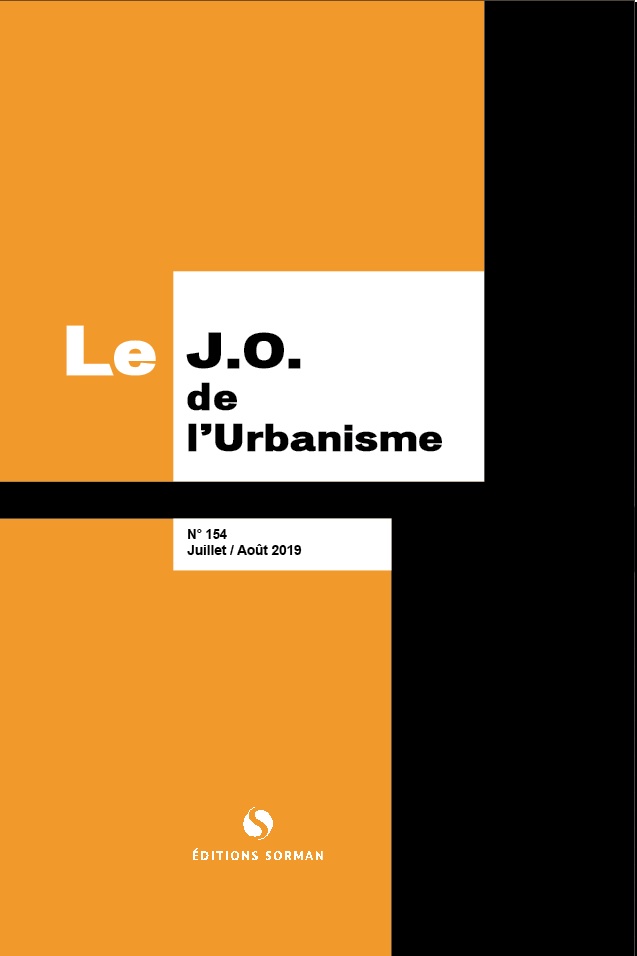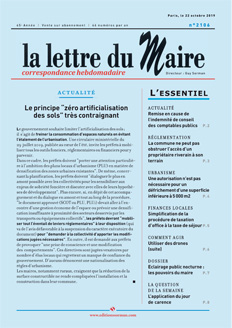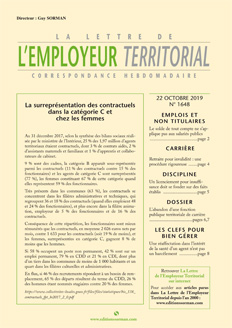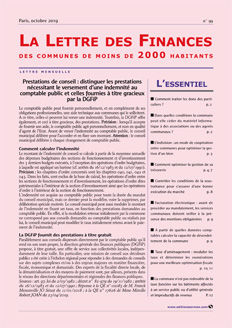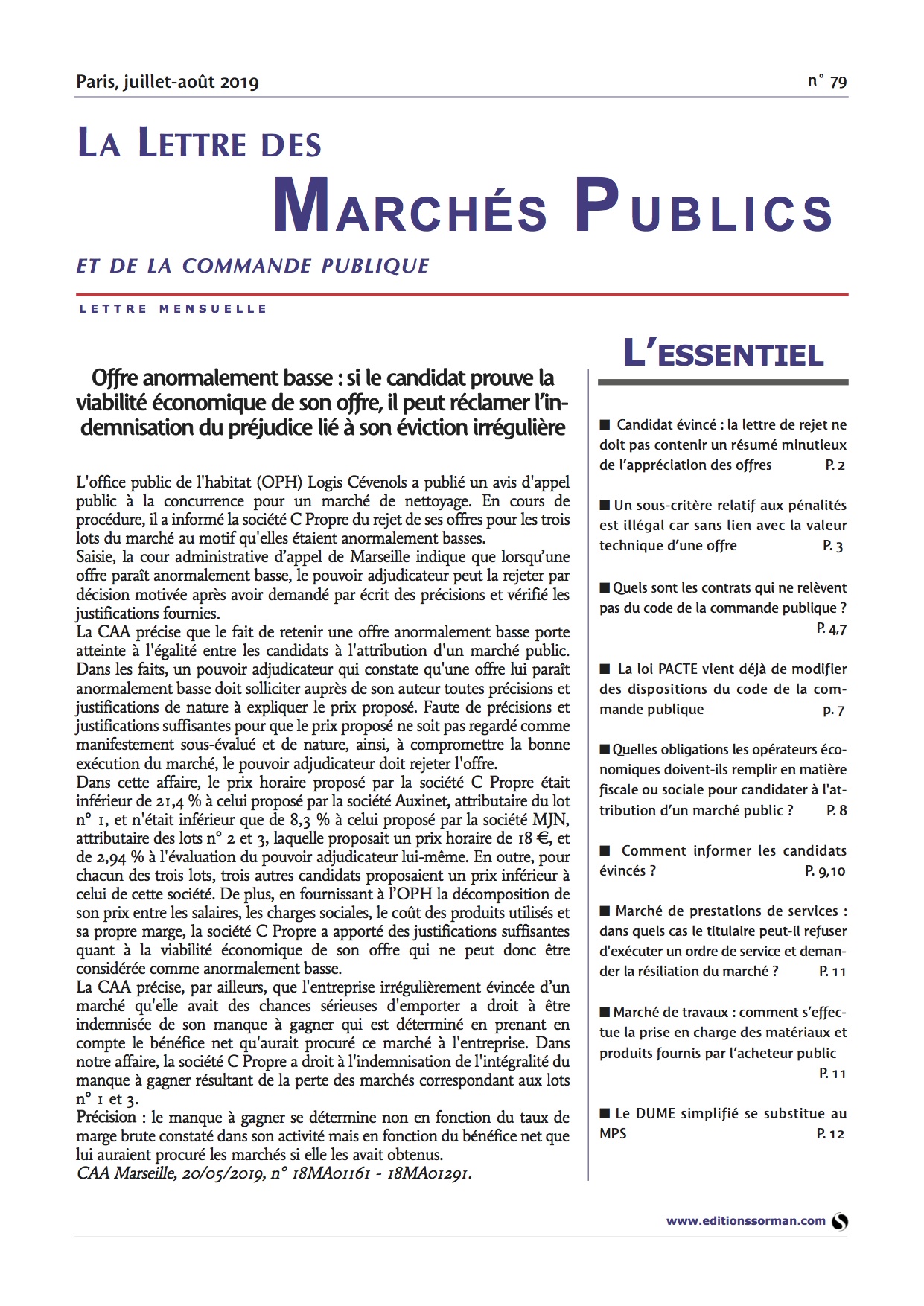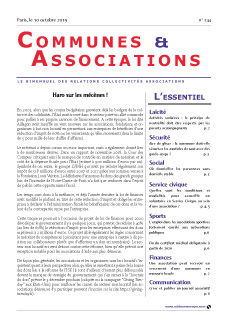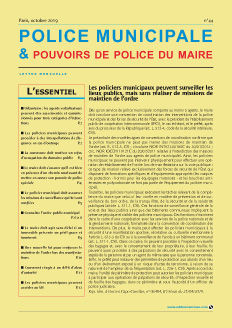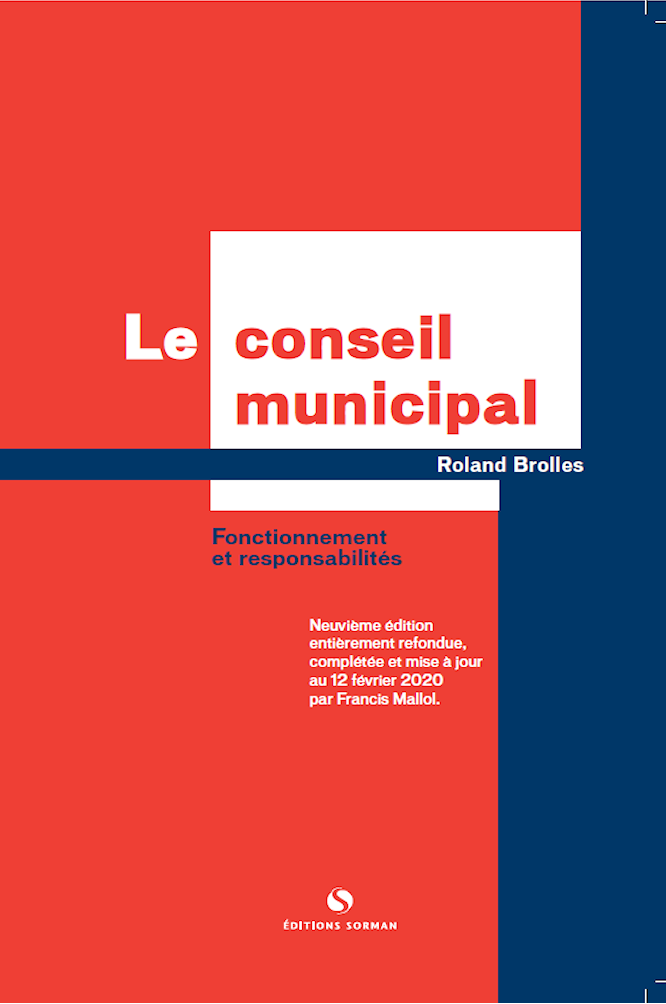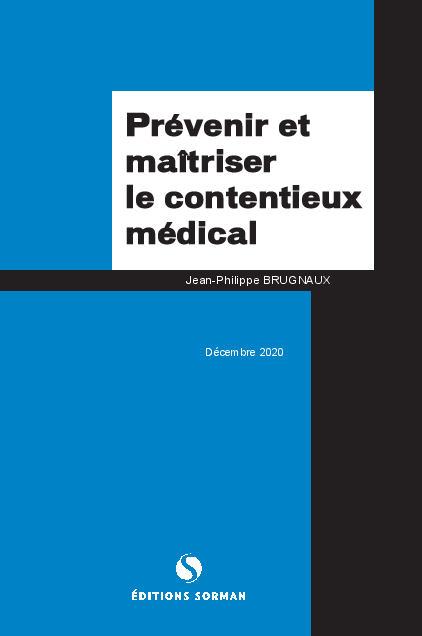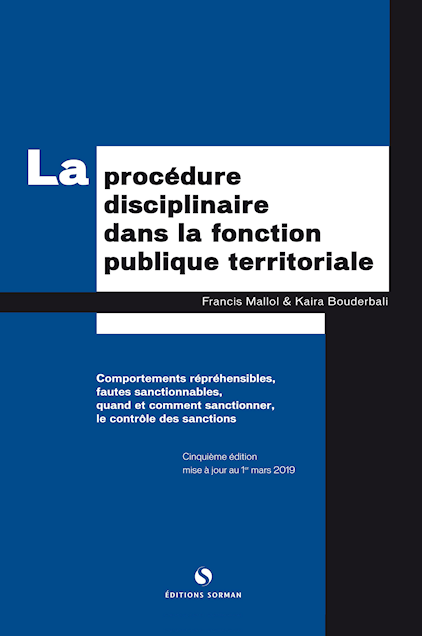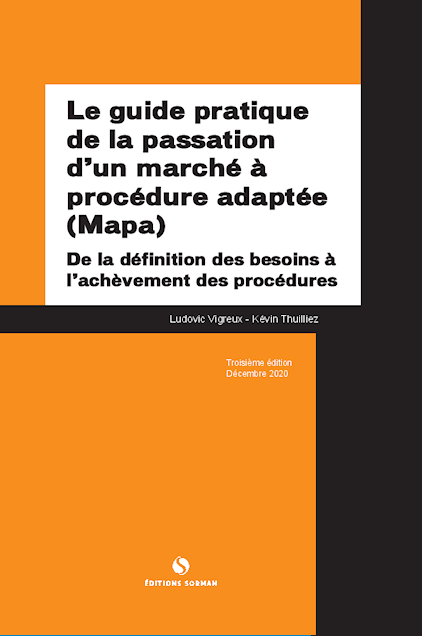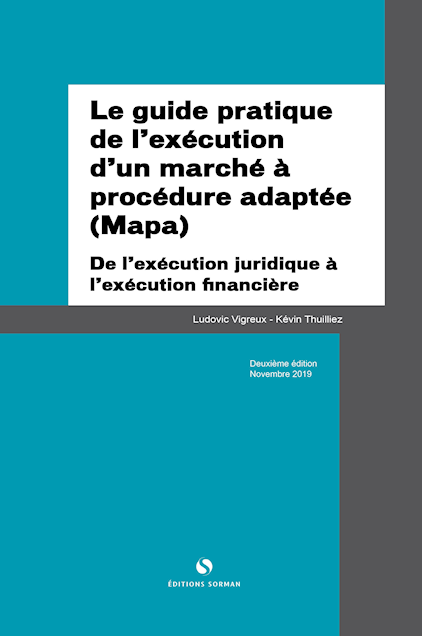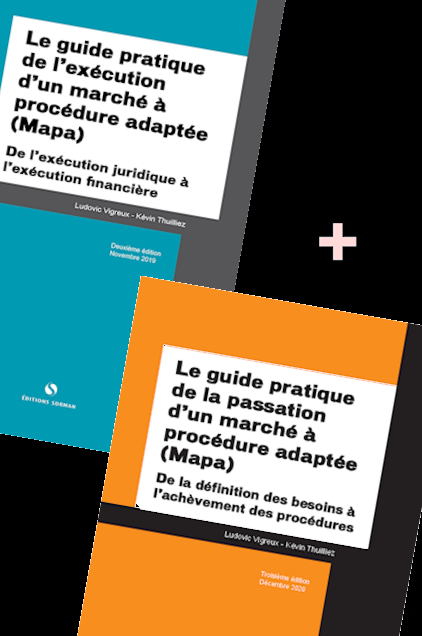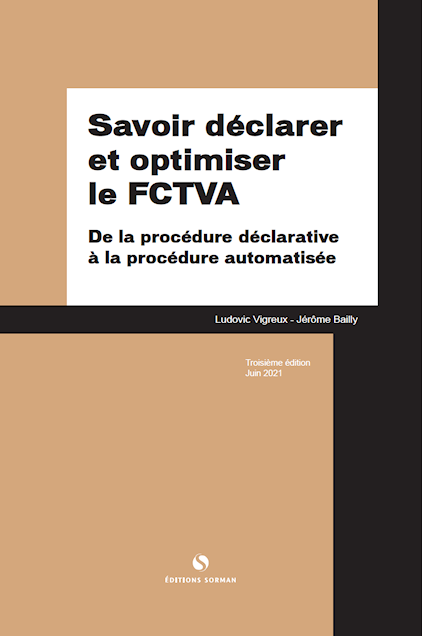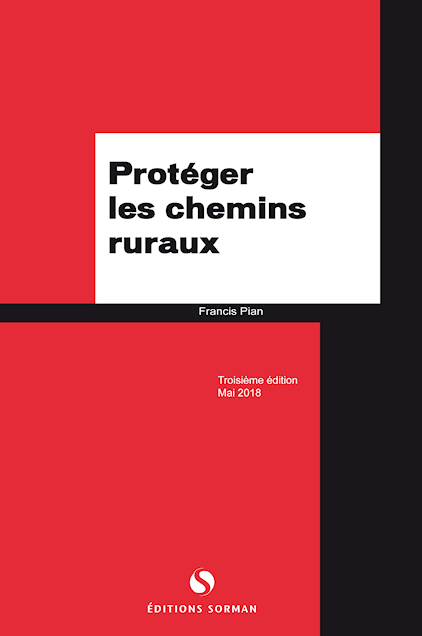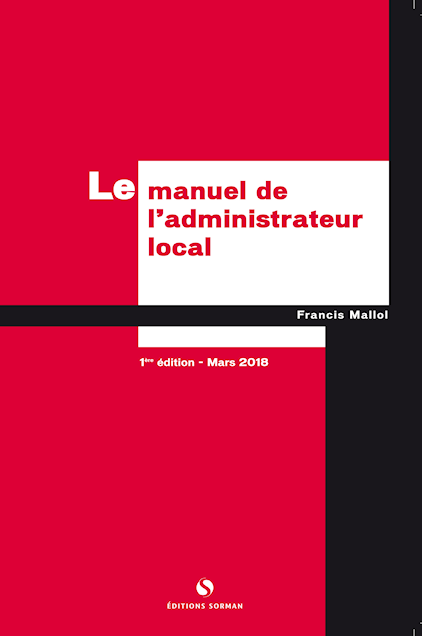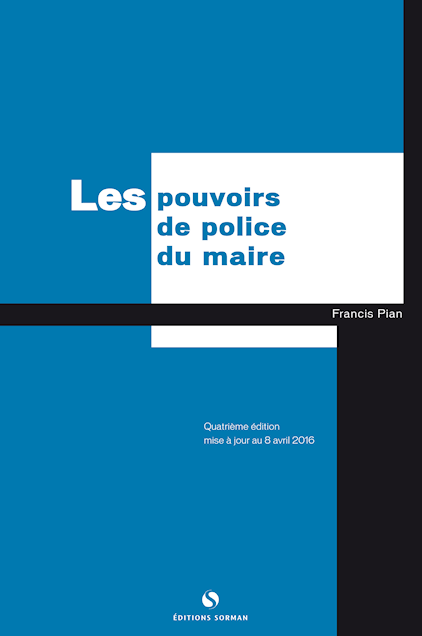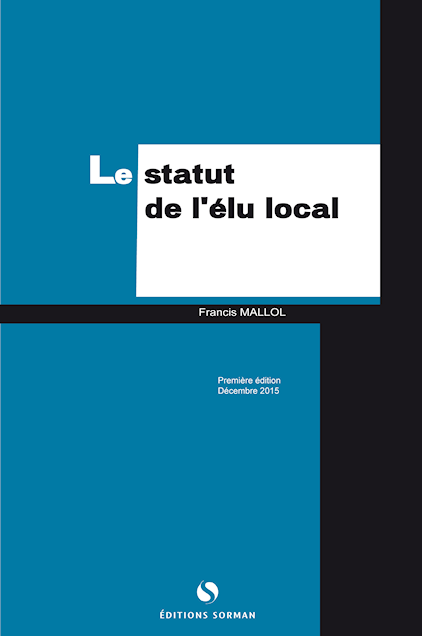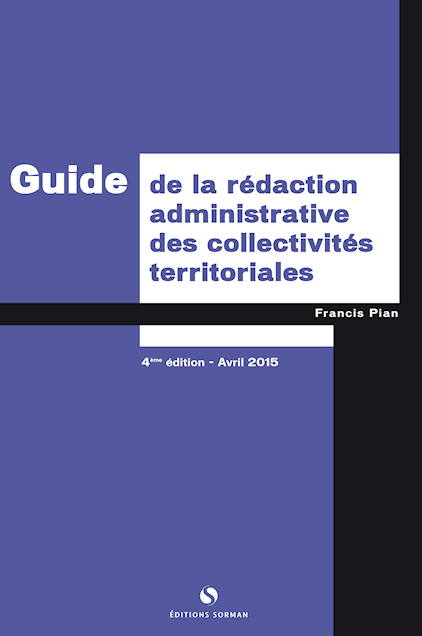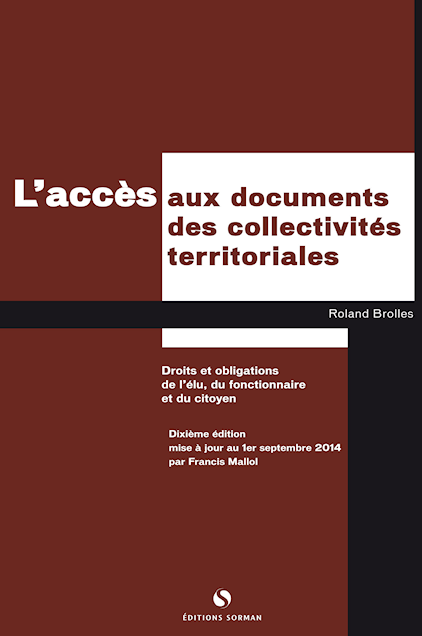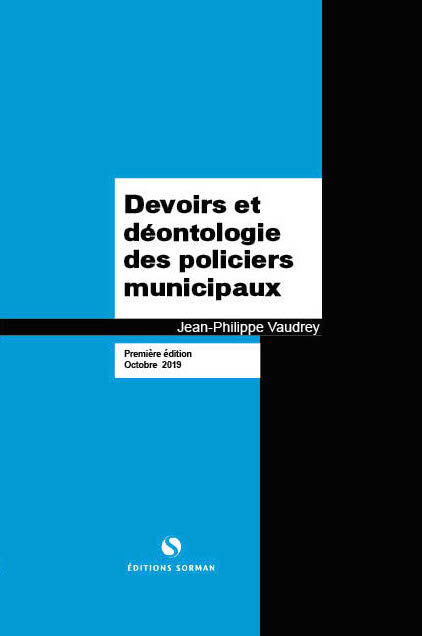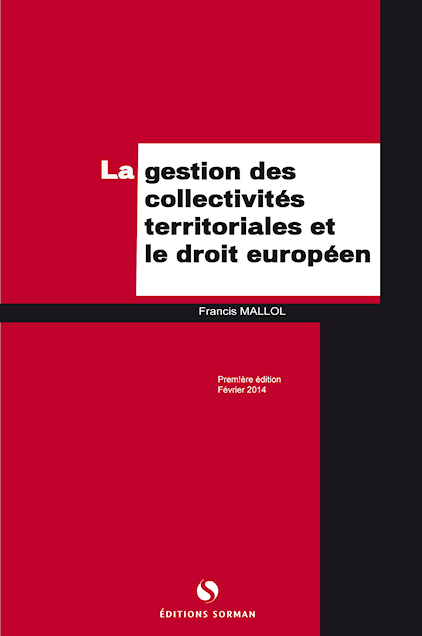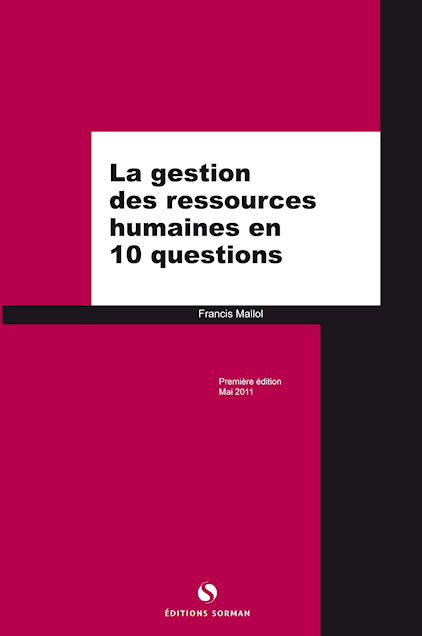Ordres illégaux : obéir ou désobéir Abonnés
Risque de poursuite pour complicité
Si le code pénal ne prévoit pas de sanction pénale en cas de non-dénonciation, la responsabilité pénale du fonctionnaire peut être recherchée sur le fondement de la complicité par abstention ou sur le fondement de certains textes limitant l'impunité du spectateur inactif. Par exemple, en 1995, le DGS de Nîmes et ses proches collaborateurs ont été jugés complices d’un délit dont ils étaient censés avoir eu connaissance, selon le tribunal, et qu’ils auraient dû dénoncer.
Devoir d’obéissance et droit à la désobéissance sont des raccourcis commodes mais qui peuvent trahir la volonté du législateur s’ils sont employés en oubliant les idées qui les sous-tendent. Constatons, tout d’abord, que ces expressions ne figurent pas dans le statut général des fonctionnaires, et s’il en est ainsi, ce n’est pas par inadvertance. La lecture de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 constituant le Titre 1er du Statut général des fonctionnaires permet de les analyser au travers de quatre propositions.
1 - : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ». S’il est fait référence à l’organisation hiérarchique et, par là, au principe hiérarchique lui-même dont on ne saurait contester l’existence et la nécessité, l’obligation en appelle surtout à la responsabilité du fonctionnaire. L’exécution des tâches laisse place à l’initiative et repose sur l’exercice personnalisé d’une compétence.
2 - « le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique… » Cette conformité n’est pas soumission aveugle. Il n’est pas écrit que le fonctionnaire doit se borner à exécuter les ordres de son supérieur. Dans ses fonctions, il garde une marge d’appréciation sur les moyens à mettre en œuvre et sur les objectifs poursuivis ; c’est la condition de son efficacité.
3 - «…sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Cette rédaction a été reprise, pour l’essentiel, d’un arrêt du Conseil d’État (CE, Langneur, 10/11/1944). Elle doit tout d’abord être comprise à la lumière des deux règles précédentes. Elle situe ensuite l’obligation de conformité face à des conditions spécifiées : existence d’un ordre, illégalité de celui-ci appréciée y compris en son caractère manifeste par le fonctionnaire qui le reçoit, atteinte portée à un intérêt général dont la gravité est là encore jugée par l’agent destinataire de l’injonction. Cela ne saurait être réduit à un droit à la désobéissance, ni légitimer n’importe quel « désobéisseur ».
4 - « Le fonctionnaire n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Cette interprétation très dialectique du principe hiérarchique inscrit le fonctionnaire au sein d’un travail collectif correspondant à une fonction publique définie par le pouvoir politique. Cette disposition dit l’essentiel de l’esprit de service public ayant présidé à l’écriture de l’article 28 du Statut général en centrant le comportement du fonctionnaire sur sa responsabilité.
Jacques KIMPE le 23 novembre 2017 - n°392 de La Lettre des Finances Locales
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline